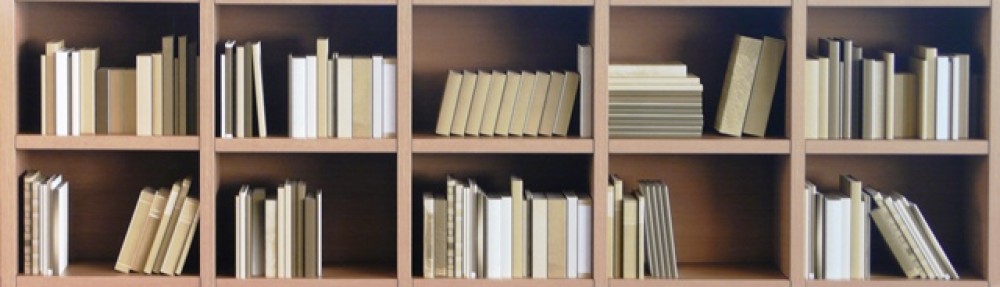La Francophonie
13/06/2024 : Remise des prix de l’Académie à l’Hôtel de ville de Nantes
Le jeudi 13 juin eut lieu la traditionnelle séance de printemps de l’académie littéraire de Bretagne et des pays de la Loire, salle Paul Bellamy, à l’Hôtel de ville de Nantes.
Dominique Pierrelée, chancelier de l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire évoqua en ouverture l’importance de cette rencontre marquée par l’attribution de deux des prix littéraires significatifs de l’activité de l’institution qu’il préside, le Grand prix Jules Verne et le Prix de l’académie.

Lui succédant, Michel Cocotier, conseiller municipal en charge du développement des pratiques artistiques en milieu scolaire et universitaire, de la lecture publique, du spectacle vivant et des arts de la rue, prit la parole au nom de Madame le maire de Nantes. Il exprima son plaisir de représenter la municipalité à cette occasion. Accueillant les membres de l’académie et l’assemblée, il rappela notamment le démarrage des travaux de la Cité des imaginaires, projet culturel d’envergure de la métropole, appelé à accueillir le grand musée Jules Verne. Exprimant sa fierté d’accompagner l’académie, il souligna l’attachement de la municipalité à laquelle il appartient aux actions de cette dernière en faveur de la lecture et des livres. « Le travail que vous menez rejoint l’attachement de la ville de Nantes pour l’imaginaire et les voyages. »
Anne Prouteau, membre de l’académie, prit ensuite la parole, en charge d’assurer l’animation de la séance et la transition entre les différents intervenants.
Grand prix Jules Verne
Ce prix récompense depuis 1981 un ouvrage de caractère vernien. Il est attribué par un jury présidé par Xavier Noël. Avant d’effectuer la présentation du lauréat, ce dernier évoqua les trois ouvrages finalistes de la compétition.
- Hélène Artaud, Immersion, Rencontre des mondes atlantique et pacifique, Les Empêcheurs de tourner en rond, La Découverte
- Fleur Hopkins-Loféron, Voir l’invisible, Champ-Vallon
- Stéphane Przybylski, Burning Sky, Denoël.
Le grand prix Jules Verne 2024 fut attribué à Fleur Hopkins-Loféron, pour Voir l’invisible, Histoire visuelle du mouvement merveilleux-scientifique (1909-1930), publié chez Champ-Vallon. La lauréate, spécialiste des imaginaires scientifiques, est née en 1990. Docteure en histoire de l’art, elle est postdoctorante au CNRS
Les raisons du jury
Xavier Noël rappela que le jury a apprécié la façon dont cet ouvrage explique la capacité des romans populaires à véhiculer de nouvelles idées scientifiques (ou pseudo-scientifiques). Il cumule de nombreuses qualités, notamment un sujet de recherche innovant et une grande richesse documentaire s’appuyant sur un mode de collecte inhabituel « qui n’est plus celui des bibliothèques, fonds d’archives et bases numérisées, mais plutôt celui des brocanteurs et libraires spécialisés, des cadeaux et trocs de livres entre amis ». Le livre permet enfin de découvrir tout un cortège d’auteurs relégués aux oubliettes littéraires, ainsi que l’intéressante imagerie qui accompagne cette abondante production écrite.
Le mouvement merveilleux-scientifique s’épanouit principalement entre 1909 et 1939. Il est concurrent à d’autres formes de romans scientifiques, comme le roman d’aventures scientifiques vernien, qui persiste. Le fondateur et théoricien de ce mouvement, Maurice Renard, est notamment l’auteur de Docteur Lerne, sous-dieu, Un homme chez les microbes, L’Homme truqué, couverture illustrée par Louis Bailly (1923)
Voir l’invisible a pour principaux mérites :
- d’explorer un angle mort de la science-fiction à la française ;
- de précéder la Science-fiction ;
- de concerner une diversité de domaines scientifiques et techniques ;
- de représenger une collecte de documents hors norme ;
- de traiter de l’imagerie qui accompagne et nourrit le merveilleux-scientifique ;
- d’avoir des ramifications contemporaines …
Prix de l’Académie
Depuis 1951, le Prix de l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire distingue un roman ou un essai. Le jury en charge de son attribution est présidé par Ghislaine Lejard. La présentation du lauréat fut effectuée par Annie Ollivier qui rappela dans un premier temps les sept ouvrages finalistes :
- Vanessa Bamberger, Les brisants, Liana Levi
- François Bégaudeau, L’amour, Verticales
- Sophie Berger, Banc de brume, Gallimard
- Sorj Chalandon, L’enragé, Grasset
- Sophie G. Lucas, Mississipi, La Contre Allée
- Dimitri Rouchon-Borie, Le chien des étoiles, Le Tripode
- Sylvain Tesson, Avec les fées, Editions des Equateurs
Le prix de l’Académie 2024 fut attribué à Dimitri Rouchon-Borie, pour Le chien des étoiles, aux éditions Le Tripode.
Présentation de l’auteur :
- 1977 : Naissance à Nantes
- Etudes de philosophie à l’Université de Nantes
- 2011 : Devient journaliste dans la presse locale : La Presse de l’Armor puis Le Télégramme.
- Ecrit des chroniques judiciaires
- 2018 : Premier livre, Au tribunal, chroniques judiciaires
- 2021 : Premier roman, Le démon de la colline aux loups
- 2021 : Ritournelle
- 2022 : Fariboles
- 2023 : Le chien des étoiles

Lors d’un échange avec Annie Ollivier, Dimitri Rouchon-Borie évoqua sa façon d’écrire, les ressorts de son inspiration comme les liens entre ses ouvrages et les réflexions issus du poste d’observation que lui confère son poste de journaliste d’assises.
Le roman présente l’histoire de Gio dont on ne sait précisément s’il a vingt ans voire peut-être un peu plus. Sa vie n’est plus la même depuis qu’une lâche agression lui a planté un tournevis dans le crâne. Désormais, il voit ce que peu de gens devinent : la beauté de la nuit, l’appel des chouettes, la grandeur de ses amis Papillon et Dolorès.
« Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que dans l’instant c’est la nuit qui parle, pas moi et c’est une voix pure, alors je serai pas capable de la refaire ensuite. »
Étonnant road movie gitan, Le Chien des étoiles est le roman de leur destin, un périple cruel et doux dans le monde des humains.
Michel Cocotier procéda ensuite à la remise de Remise de la Médaille de la ville de Nantes à Fleur Hopkins-Loféron et à Dimitri Rouchon-Borie.

Le “vrai-faux” manuscrit de L’Etranger, d’Albert Camus
Maître de conférences en littérature française à l’Université Catholique de l’Ouest à Angers, Anne Prouteau a soutenu une thèse intitulée « Albert Camus ou le présent impérissable ». Membre de l’académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire, elle est surtout la présidente de la Société des Études Camusiennes. C’est au titre de cette expertise qu’elle a évoqué la singulière histoire du manuscrit rédigé par l’auteur, après la publication originale de L’Étranger, vendu en 1958, puis en 1991 avant d’être cédé à un collectionneur français le mercredi 5 juin 2024. Vendu 656 000 euros aux enchères, il illustre la pratique de la “recomposition” d’ouvrages par les écrivains. Signé et daté « avril 1940 » par Albert Camus, il fut en fait recopié intégralement en 1944 avec des ratures et des croquis de l’auteur.
La presqu’île de Julien Gracq, par Eric Chartier
En fin de séance, Eric Chartier, membre de l’académie, récita un important extrait de son spectacle « La presqu’île », inspiré de l’ouvrage éponyme de Julien Gracq, dont il est un grand admirateur. Ce livre comprend trois récits distincts : « La route », La presqu’île » et Le Roi Cophetua ». Il fut publié par André Dalmas dans « Le Nouveau Commerce », cahier 2, automne-hiver 1963. Dans le texte, évoqué par Eric Chartier, Simon retrouve Irmgard, dans un hôtel de Piriac, après avoir sillonné en voiture la presqu’île guérandaise.
« La sensation particulière aux mauvais rêves où on se fourvoie, tandis que l’heure s’écoule impitoyable, de plus en plus loin du rendez-vous où on vous attendait de toute urgence, rôdait sur ces solitudes revêches. Il se sentit un moment étrangement rejeté. Il regardait des deux côtés du chemin défiler les champs de choux, les mares, les haies sans oiseaux – une terre sans accueil qui se recouchait, qui semblait maussadement retirer sa promesse. »
La Presqu’île, Julien Gracq, éd. José Corti, 1970, La presqu’île, p. 82
En clôture de la séance, Dominique Pierrelée invita les membres de l’académie et l’assemblée au cocktail offert par l’Hôtel de Ville de Nantes.

La minute de l’Académie par Florence Ladmirault
La séance solennelle du 13 juin à 18H
La minute de l’Académie par Noëlle Ménard
Le café littéraire : les livres de l’été
Café littéraire du 6 Juin 2024
Le Café littéraire
Jeudi 6 Juin 2024
14h15 – 16h
Muséum d’histoire naturelle
LES LIVRES DE L’ÉTÉ
Animé par JEAN AMYOT D’INVILLE
Programme
14h15 – 14h40 Les Livres de l’Ouest
Actualité des livres en région, préparée par Noëlle Ménard et Jean-Yves Paumier
Jean-Yves Paumier. Katell Faria. Au vent des mers australes. Stock
Noëlle Ménard André Derval. Michel Ragon singulier et pluriel (Albin Michel)
15h40 – 15h45 Les livres de l’été
Henri Copin Anna Moï 80 mots du Vietnam ( Asiathèque)
Claire Voisin-Thiberge. Sophie Berger. Banc de brume (Gallimard)
Jean- Luc Jaunet Leonardo Padura Ouragans tropicaux (Métailié )
Gaëlle Peneau David Foenkinos La vie heureuse ( Gallimard)
Jean- François Caraës Maria del Carmen Márquez Gómez, Hélène Rousseau-Chambon, L’architecture privée à Nantes au XVIIIe siècle, PUR
14h45 – 16h Coups de cœur
Henri Copin. Gurvan Kristanadjaja. Amok mon père. Philippe Rey
Jean-Luc Jaunet. Joseph Kessel. Les Cavaliers. Gallimard
Noëlle Ménard. JMG Le Clézio. Identité nomade. Laffont
Claire Voisin-Thiberge. Sonia Devillers. Les exportés. Flammarion
Jean-Yves Paumier.Aventurières de la mer. Ouest-France
Annie Ollivier. Dimitri Rouchon Borie Le chien des étoiles Le Tripode
Gaëlle Peneau. François Lecointre. Entre guerres. Gallimard
Jean-François Caraës. Sébastien Le Fol. Les lieux de pouvoir. Perrin
Jean Amyot d’Inville. Gilles Martin-Chauffier. Clause de conscience. Grasset
La minute de l’Académie par Annie Ollivier
Le Prix de l’Académie 2024
La minute de l’Académie par Vincent ROUSSEAU
Hommage à Michel Ragon poète, romancier
L’Académie et la Maison régionale de l’Architecture
Du 14 mai au 14 juin : Écrire le territoire : À l’occasion d’un cycle consacré à l’architecture et l’écriture, la Maison de l’architecture des Pays de la Loire invite le Pavillon de l’Arsenal et l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire le temps d’une exposition.
Alors que de nombreux écrivains contemporains s’intéressent au fait architectural et que l’écriture constitue un outil non négligeable pour les architectes, l’exposition écrire le territoire révèle les liens entre les pratiques de l’écriture et la représentation des espaces, des usages, sensations et histoires que l’architecture fait naître.https://www.ma-paysdelaloire.com/
Une trentaine de textes publiés dans les Cahiers de l’Académie sont exposés.
Centenaire Michel Ragon
Les manifestations débuteront à Nantes le 21 mai au Passage Sainte- Croix : Exposition jusqu’au 8 juin, spectacle, conférence, lectures. Pour en savoir plus https://www.passagesaintecroix.fr/programmation-culturelle/expo-flash-michel-ragon-enfant-du-bouffay/
Une journée avec Michel Ragon le jeudi 30 mai en présence de Françoise Ragon.
L’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire dont Michel Ragon était membre d’honneur depuis 1989 commémore le centenaire de sa naissance (1924 – 2020) en proposant, associée à l’Université Permanente, au Musée d’Arts de Nantes, ainsi qu’au Centre d’histoire du travail, un cycle de conférences publiques et gratuites. (Voir programme en rubrique animations)
La minute de l’Académie par Patrick Barbier
La musique dans l’Académie